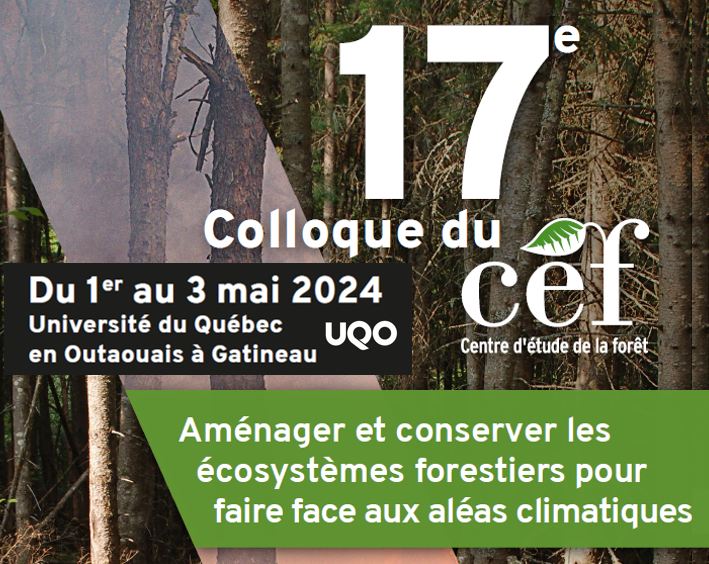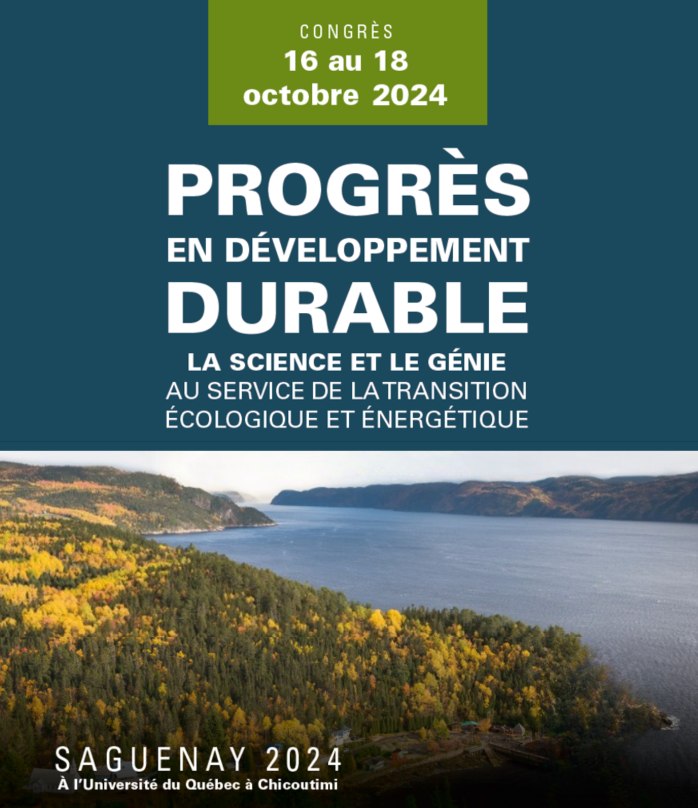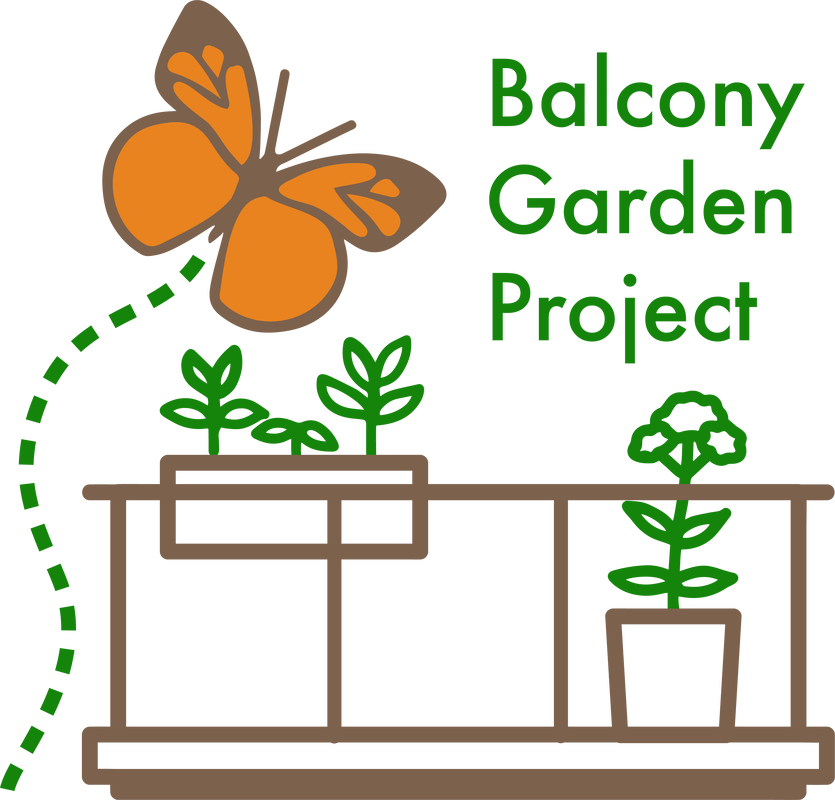Gauthier Lapa
Postdoctorat
Ecologie forestière, Ecophysiologie
ISFORT/Université du Québec à Montréal
Codirecteur: Christian Messier
Codirecteur: Alain Paquette
Vous pouvez me suivre sur Researchgate ![]() et télécharger mon CV
et télécharger mon CV ![]()
THÈMES DE RECHERCHE
Lors de mon doctorat, je me suis intéressé à la tolérance des arbres aux stress abiotiques (sécheresse, feu) à l’aide d’une approche physiologique, basée sur l’utilisation de l’eau et l’assimilation de la lumière. Mon arrivée à l’UQAM m’a permis d’aborder de nouvelles thématiques. Je m’intéresse maintenant également à la diversité fonctionnelle et son influence sur les individus (plasticité phénotypique) et sur la résilience des écosystèmes forestiers. J’ai aussi eu la chance de pouvoir exploiter de nouvelles méthodes (spectrométrie, télédétection).
PROJETS

Développement d’une méthode de télédétection par drone pour les inventaires de nerprun dans des forêts urbaines
La propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) représente l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité et le maintien des écosystèmes. Au Canada, près de 500 espèces végétales introduites sont considérées comme envahissantes, elles engendrent chaque année des dépenses importantes ainsi que de nombreux effets indirects, mais néfastes causés par la perte de services écosystémiques. Comme de nombreuses forêts du sud du Québec, les espaces boisés de Laval sont mis en danger par le nerprun, dont deux espèces exotiques envahissantes (cathartique et bourdaine) ont été observées. Leur présence est en forte augmentation depuis quelques années. Grâce à leur croissance rapide et leur reproduction importante, ils rentrent en compétition avec les espèces indigènes et engendrent une perte de diversité, rendant ainsi les milieux plus fragiles.
La première étape dans le contrôle des EEE est de les localiser et de déterminer leur envergure pour ensuite pouvoir agir efficacement. Ces inventaires sont couramment réalisés par des équipes à pieds, représentant un temps de travail et des coûts importants. Depuis quelques années, des avancées technologiques ont considérablement augmenté notamment la précision et l’accessibilité de méthodes de télédétection par drones. Par ce projet, nous souhaitons utiliser ces nouvelles technologies afin de développer un outil plus rapide, moins coûteux, mais fiable, pour l'inventaire du nerprun.

Mise en place d’un projet sur la résilience des érablières face aux changements globaux
L'érable à sucre est exploité depuis plusieurs siècles en raison de la concentration particulièrement élevée en sucre de sa sève. Malgré son importance économique, notamment au Canada, les paramètres qui régulent le mécanisme de la coulée à l'échelle de l'arbre sont encore mal connus. Il existe également de nombreuses lacunes en ce qui concerne la capacité des érablières à résister aux changements climatiques. Le but de ce projet est de mettre en place une érablière de production et de recherche qui servira par la suite à la réalisation de différentes expérimentions qui auront pour principaux objectifs 1) d'identifier les différents facteurs climatiques, sylvicoles et abiotiques qui influencent la quantité et la qualité de l'eau d'érable à l'échelle de l'arbre et du peuplement et 2) de permettre le maintien des érablières en santé et résistantes aux changements globaux.

Développement d’outils permettant l’estimation du dépérissement des frênes de parcs urbains infestés par l’agrile par télédétection par drone
L'agrile du frêne, un coléoptère natif d'Asie, a été détecté au Michigan, États-Unis et à Windsor, Ontario en 2002. À l'heure actuelle, il est présent dans 35 états américains et cinq provinces canadiennes. Les dégâts sont en grande majorité causés par les larves qui creusent des galeries sous l'écorce et perturbent les transferts de sève, affaiblissant fortement les arbres touchés. Au Canada, toutes les espèces de frênes indigènes y sont sensibles, avec un taux de mortalité proche de 100 % après quelques années. Afin d'améliorer la détection précoce des arbres infestés, l'utilisation de données de réflectance (c.-à-d. la quantité de lumière réfléchie par le feuillage pour des longueurs d'onde données) représente un outil pertinent. Il permet la détection des premiers signes de jaunissement, avant qu'il ne soit détectable par l'œil humain. La fiabilité de cette méthode a été prouvée par le passé dans différentes études, mais les méthodes employées étaient lourdes et coûteuses. Par ce projet, nous souhaitons utiliser ces nouvelles technologies afin de développer un outil plus rapide, moins coûteux, mais fiable, pour estimer l'état de santé des frênes.

Ecophysiologie de la coulée de l’érable à sucre
L'érable à sucre est exploité depuis plusieurs siècles en raison de la concentration particulièrement élevée en sucre de sa sève. Malgré son importance économique, notamment au Canada, les paramètres qui régulent le mécanisme de la coulée à l'échelle de l'arbre sont encore mal connus. L'objectif de ce projet est de prendre en compte l'ensemble des facteurs connus susceptibles d'influencer la coulée à l'échelle de l'individu. C'est à dire, à la fois les paramètres intrinsèques et extrinsèques. Les résultats obtenus aideront les acériculteurs à mieux aménager leurs érablières afin d'optimiser la production d'eau d'érable. À plus long terme, les connaissances acquises permettront les propriétaires à mieux faire face aux effets prévus des changements climatiques sur la dynamique de la coulée chez l’érable.

Diversité des forêts du Québec
Dans le contexte actuel des changements globaux, l’aménagement de nos forêts représente un défi majeur. Face à cette réalité, nos pratiques visant à contrôler et prédire l’évolution de nos forêts ne sont plus assez efficaces et nous devons revoir notre façon de les gérer. L’utilisation d’une approche basée sur diversité et la redondance fonctionnelle pour l’aménagement de nos forêts semblent prometteuses pour en augmenter la résilience face aux perturbations. L’objectif de ce projet est d’acquérir des connaissances sur l’évolution de la diversité et de la redondance fonctionnelle des peuplements forestiers au Québec au cours des 30 à 40 dernières années. Les décisionnaires auront alors la capacité d’utiliser ces données pour planifier la gestion à long terme des forêts du Québec.

Plasticité de traits foliaires le long d’un gradient de diversité fonctionnelle
En sylviculture, l’utilisation de peuplements composés de différentes essences, ayant une diversité fonctionnelle élevée, plutôt que de peuplements monospécifiques semble la stratégie à privilégier pour une gestion plus durable et plus rentable des forêts. Une diversité spécifique et fonctionnelle importante peut avoir différents effets positifs sur différents processus écosystémiques. Bien que des relations entre la diversité d’un écosystème et sa productivité ont été observées à de nombreuses reprises, les mécanismes qui modulent ces relations sont encore mal connus. Parmi les mécanismes possibles, nous nous sommes intéressés aux traits foliaires. Sur le site IDENT (International Diversity Experiment Network with Trees) de Montréal, nous avons mesuré différents traits foliaires qui sont utilisés comme indicateurs du taux photosynthétique maximum, du taux de croissance relatif et de la disponibilité des ressources dans l’environnement.

Suivi de l'accumulation et de la fonte de la neige
La connaissance du volume d'eau stockée dans le manteau neigeux ainsi que la vitesse de la fonte est un paramètre important à prendre en compte dans les prévisions hydrologiques printanières. Le couvert forestier, par ses branches et son feuillage, a une influence importante sur la quantité de neige qui va s'accumuler au sol, ainsi que la vitesse de la fonte. En raison de sa conception et du climat local, le site IDENT de Montréal représente un site idéal pour cette problématique.
L’évolution de la quantité de neige accumulée au sol a été suivie pendant deux années, du début de l’hiver jusqu’à la fonde au printemps. Ces données permettent de calculer le taux d'interception et d'accumulation de la neige en fonction du couvert forestier. Cala pourra par la suite aider à optimiser l’aménagement des zones à fort risque de crues. Projet en collaboration avec Jon Urgoiti Otazua ![]() .
.